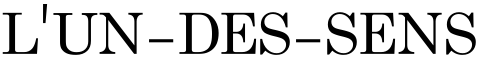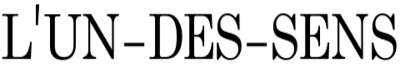Spiritualité

Le bonheur, un mystère si rechercher.
Le bonheur, un sujet délicat dont la définition reste toujours énigmatique pour nombre d'entre nous.
Quelles sont les valeurs du bonheur ? Dans la société, et plus particulièrement chez les marchands de publicité, ne cessent de nous renvoyer des images sur ce bonheur.
L'image d'un couple et leurs deux enfants (fille et garçon) sourire aux éclats dans un jardin, avec une belle maison pour toile de fond, a un impact certain sur notre subconscient, elle crée en nous l'envie et déclenche un sentiment déstabilisant.
Un message dont le but est de nous faire croire que "le bonheur" existe et que nous l'avons toujours pas trouvé, et pour cela, il nous suffirait de franchir la porte de l'agence fièrement affichée...
Cela crée un sentiment de malaise inconscient, une culpabilité qui nous renvoie l'image de notre incapacité a le trouver.
La recherche du Bonheur
Comment, trouver une chose dont on ignore les caractéristiques ?
Quels sont les paramètres qui fondent "ce bonheur" ?
C'est dans la question comme toujours que se trouve la réponse, dès lors que nous les posons (les questions), le raisonnement avec sa logique intellectuel va fractionner le réel pour essayer de trouver dans ou sous quelles conditions nous sommes heureux.
Les dites conditions s'expriment souvent sous la forme suivante : lorsque j'aurais, ceci ou cela (voiture, maison, téléviseur...) Je serai heureux, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir, etc.
Cette phrase de Woody ALLEN pleine de dérision reflète parfaitement cet état d'esprit : Ah qu'est-ce que je serais heureux si j'étais heureux !
Nous nous projetons dans le fictif, une fuite dans un futur prometteur, là ou les publicitaires cachent leurs trésors...
Chacun connaît l'expression : l'argent ne fait pas le bonheur que certains matérialistes ont transformés sous forme d'humour :
s'il ne fait pas ton bonheur, donne-le-moi. Ou plus séduisante, puisque rationaliste : Il ne fait pas le bonheur, certes, mais il y contribue !...
Pourtant, l'expérience de chacun dans le quotidien, a vécu le désir d'un objet accessible financièrement, dont l'acquisition finale laisse un arrière-goût amer après que ce fameux "plaisir" se soit dissipé, tant d'effort juste pour ça...!?
La bonheur est dans son intention
Qu'est-ce que cela veut dire ?
Cela signifie que le bonheur ne possède aucun critère ou valeur particulière accessible à notre intellect, il n'existe nulle part, un mode d'emploi qui serait complet, pratique qui nous dispenserait de la souffrance, le bonheur n'est pas une recette de cuisine.
Il y a des personnes qui nous paraissent disposés de tous les éléments et paramètres pour vivre heureux.
Ils disposent de bien matériel conséquent, ils ont accès aux soins aisément, ils voyagent régulièrement etc.
Mais qui dans leurs Intimités souffrent autant que n'importe lequel d'entre nous, c'est juste un point de vue différent, la souffrance demeure la même.
Cela, ne les empêchent nullement d'en vouloir encore davantage, d'être malade, de s'ennuyer, d'être envieux de celui qui a plus qu'eux, etc.
Ça ne les protège pas plus de ce manque, de la fragilité, de la peur, de la colère, de la tristesse, de la maladie, de la mort, du deuil, bref de tout ce qui nous fait souffrir, de ce qui fait notre malheur.
Vendu ici et là comme le modèle du bonheur, la société de consommation érige l'argent comme élément indispensable pour être heureux.
Le bonheur vu sous cet angle matérialiste, n'est qu'une chimère, une illusion supplémentaire au rayon des idéalismes en tout genre.
La société est parvenue à nous vendre l'apparence et le plaisir comme norme du bonheur, qu'il faut impérativement soigner (l'apparence), sous peine de révéler notre fragilité et l'impuissance qui nous fait tant souffrir, pour cela elle suggère du plaisir comme remède.
Cette vision du bonheur n'est qu'un leurre, un appât pour l'individu, qui se retrouve entraîner dans une course effrénée pour ne pas avoir le temps de se poser de questions. De gamberger comme le dit le dicton, c'est-à-dire d'angoisser par l'absence éventuelle d'une réponse. Ce qui serait comme une évidence inconsciente, qu'il n'existe pas de solution, hormis la soumission par l'acceptation de vivre la vie telle qu'elle se présente à nous.
Il ne s'agit pas ici de substituer la recherche du bonheur par l'anxiété, mais de constater que la souffrance que nous cherchons à fuir est une exploitation par ladite société, c'est son fonds de commerce. Alors, qu'en réalité, elle est tout aussi ignorante que nous le sommes.
Le bonheur tel qu'il se définit dans la société, n'est ni plus ni moins qu'une drogue. L'émotion à ces effets secondaires liés aux heurts de l'illusion. Tout ce qui est périssable est une illusion, de ce point de vue, le bonheur nous est inaccessible.
Personne ne détient la connaissance de notre bonheur, excepté nous-mêmes.
Notre désir d'appartenance à la communauté humaine est puissant. Tant nous ressentons et vivons mal, très mal la séparation, qui est due à notre particularité et notre ignorance.
Qui n'est qu'une représentation de notre fractionnement. Notre individualité nous fait subir le sentiment d'être séparé de tout. Ce qui génère de l'angoisse que nous cherchons à combler et il est vain de le faire et sain de le vivre et de l'accepter...
Le bonheur ne s'achète pas, ne se vend pas, ne se donne pas, ne se prête pas, ne ce rêve pas, ne se trouve pas.
Le bonheur, se VIT, c'est votre intention et votre force à accepter et connaître la vie telle qu'elle est. Et non telle que vous voudrez qu'elle soit, qui vous la fera aimer, c'est de la vérité que naît le bonheur.
L'ignorance des causes d'un malheur qui vous tombe dessus, accentue le sentiment d'impuissance et de fragilité...Hors, ce n'est qu'un sentiments lier à la conscience même du problème. Lorsqu'un décès surgit dans notre intimité, c'est d'une violence sans commune mesure avec les autres malheurs, et ce d'autant que l'ignorance de ce sujet est grande. Le malheur est l'opposé du bonheur dans le principe qu'est la polarité. Ce principe de la polarité est secondé par celui du rythme, ce n'est que lorsque le contraire se manifeste dans notre vie que notre conscience s'éveille et mesure à quel point nous étions heureux avant cet événement du décès et cela me sert de leçon pour mieux assimiler ce phénomène qu'est la vie.
La vie, nous dévoile son mystère à partir de l’expérience, c'est cela même la connaissance, éprouver une situation c'est autre chose que de la comprendre à travers un quelconque savoir théorique ou une imagination débordante. Le réel est, et rien ne peut le substituer ! C'est là, que l'acceptation interviens...
L'amour est une dimension qui englobe le tout, il est sans préférence, il est l'acceptation même.
Il existe trois niveaux d'amour :
- Eros
- Philia
- Agappé
Cette appellation, issu du grec qui en langage courant se traduit par un amour qui :
- Prend
- Partage
- Donne
Dans la société nous rencontrons en premier et majoritairement l'amour qui prend, ses principaux adjectifs sont :
j'exige, je veux, c'est à moi, il me le faut... Et se décline au niveau intellectuel par : je souhaite, je désire, j'aimerais...
Leurs ordres d'utilisations, évoquent le niveau d'évolution et la maturité des individus. C'est un amour qui est symbolisé par l'intérêt individuel, de l'égoïsme.
L'amour qui partage, est compris et présent dans la société sous la forme d'échange et connu sous le terme de solidarité, c'est un intérêt qui revêt une certaine conscience de l'existence de l'autre. Il s'obtient par :
- Un contrat
- L'argent
- Des conditions
- Le service
il se manifeste dans les expressions courantes par : je déteste, j'adore, j'apprécie ou pas, j'aime, je n'aime pas, me conviens ou pas...en fonction de l’intérêt qu'il représente pour la personne.
Je suis conscient que pour obtenir ce dont je voudrais, il me suffit de donner quelque chose en échange. C'est un amour qui relève de la stratégie, de la ruse, de la collaboration, tout cela relègue l'Amour en un commerce, que je vend ou achète.
L'amour qui donne, est un amour qui est libéré, qui s’affranchit de l'attachement, de la possession, il s'atteint par le vécu, l'expérience et la sagesse, une conscience de sa propre position et rôle dans la vie. On le distingue par :
- Le don
- La sérénité
- La disponibilité
- L'acceptation
Un amour qui donne, est sans doute ce qui se rapproche le mieux de la définition du bonheur. Nombre d'entre-nous ont, une vision erronée de l'amour.
Ce n'est pas parce que les choses ou personnes, sont bonnes que nous les aimons, mais c'est parce que nous les aimons, qu'elles sont ou deviennent bonnes...
À ce sujet, la filiation, nous éclaire davantage, une personne que l'on aime, une mère, un père, un enfant, etc. Nous les aimons et ce indépendamment de leurs valeurs. L'amour de l'enfant est le plus révélateur, son innocence nous interdit tout jugement à son sujet, nous l'aimons et c'est tout. Quelle que soit l'offense ou la bêtise qu'il est pus commettre, notre amour pour lui demeure le même. Et c'est cela qui contribuera à le rendre meilleur qu'il ne serait sans cet amour.
La constance du bonheur
La satisfaction des désirs n'est pas un bonheur durable. Il procure une sensation de plénitude éphémère.
La satisfaction des plaisirs, de désirs, la joie, l'espoir, etc. Sont des paramètres intrinsèques, ils sont en nous. Si nous les concevons comme étant le bonheur, alors, il n'y a aucun mérite, aucune prise de conscience. Bien que cela puisse être une quête pour beaucoup d'entre nous. Et ce genre de quête est comme un récipient percé, il demande toujours à être rempli. Ou une dépendance à la drogue, augmentée les doses et rapprochée les prises...
Le bonheur à des degrés, il est graduel, son amplitude et sa constance sont croissantes, il se trouve dans la moindre satisfaction organique, émotionnelle et spirituelle.
Cependant, le vrai bonheur, le durable est sans cause, sans objet, il ne dépend d'aucune situation. Il est la conséquence d'une conscience qui s'est réalisée, par d'une pratique volontaire et constante. Une conscience parvenue à la maîtrise de ses défauts, de ses vices. Celui du respect des lois universelles, acquise de son expérience, qui pas à pas au fil de son parcours a réussi à faire le tri entre ce qui est vrai et faux, a hiérarchisé les valeurs de ses connaissances et retrouvé sa véritable nature.
La difficulté, l'effort, la souffrance, la douleur requièrent une vertu pour les surmonter. Celui de la volonté (force), de la prudence face à ses propres vices, de la tempérance pour freiner un excès d'ardeur et obtenir une justesse (justice) de pensée, de parole et d'agir, c'est la connaissance qui est le fondement de la conscience et non le savoir intellectuel.
En résumé
Le bonheur c'est l'unité, lorsque l'on se rassemble, on cesse le fractionnement que crée nos egos par sa recherche de la différence, de sa particularité, sa singularité. La singularité est une évidence, point besoin de la cultiver, c'est la ressemblance qui exige un vrai travail, elle demande une prise de conscience de cet état d'être séparer. La parabole d'Adam et Eve chasser du paradis, n'est autre que cette prise de conscience de la séparation de ces origines. Une feuille d'arbre, se sent unique et singulière des autres feuilles, cependant, elle appartient à une brindille différentes. Cette brindille est relier à une branche, de même que cette branche se sent singulière en rapport autres, mais, elles appartiennent toutes au même tronc qui est nourrie par les même racines. Il en est de même pour nous Être-humain, histoire particulière à chacun (la feuille), appartenance familiale(brindilles), couleurs de peaux, culturel, cultuel (les branches), et nous appartenons tous à la même espèce, celle de l'Homme (le tronc), et sommes tous nourrit et sans exception par la Divine création (les ou la racine(s).
Un conte, en toute simplicité qui résume et contribue à la définition du bonheur...Cliquer ici
Ci-contre, une vidéo à découvrir pour alimenter le sujet